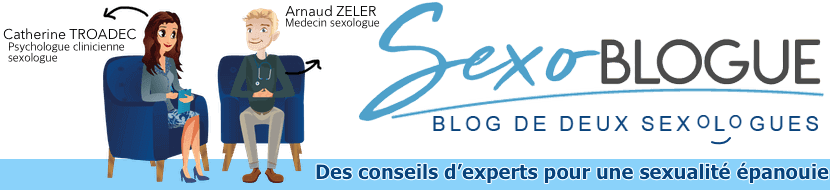Se priver de masturbation pour le carême : une fausse bonne idée ?

À l’approche de Pâques, le carême revient dans les débats, surtout chez les jeunes croyants.
Comme le rapporte une enquête de France Info diffusée ce dimanche 13 avril 2025, TikTok, Instagram et YouTube regorgent désormais de témoignages de jeunes chrétiens qui se lancent dans des défis de jeûne « modernisé » : moins de sucre, moins d’écrans, moins de confort… et parfois, plus du tout de sexualité !
Parmi les renoncements emblématiques, la masturbation fait figure de défi ultime, entre purification du corps et quête de maîtrise de soi1.
Mais que penser, d’un point de vue sexologique, de cette abstinence temporaire ? Est-elle bénéfique ? Nécessaire ? Ou contre-productive ?
I. La masturbation : une pratique universelle… mais récemment réprimée
La masturbation est une pratique humaine universelle, présente dans toutes les cultures et chez de nombreux primates (et même chez les dauphins)…
Pourtant, dans l’histoire occidentale, elle a longtemps été frappée d’anathème. Le paradoxe est que cette répression est extrêmement récente à l’échelle historique : elle ne prend réellement son essor qu’au XVIIIe siècle, sous l’influence du médecin suisse Samuel Auguste Tissot. Dans son ouvrage L’Onanisme, Tissot soutient que la perte de semence affaiblit le corps et l’esprit, fondant une théorie pseudo-médicale qui aura un retentissement mondial pendant près de deux siècles.
Comme le rappelle le Dr Philippe Brenot, psychiatre et anthropologue, dans Éloge de la masturbation, « la véritable guerre contre la masturbation n’a que deux siècles d’existence. Elle est née du croisement de la morale chrétienne, du rationalisme médical et de l’obsession hygiéniste » 2. La répression ne venait donc pas des Évangiles eux-mêmes, mais d’une construction socio-médicale moderne.
Cette stigmatisation a perduré jusqu’au XXe siècle, pesant particulièrement sur les femmes. Encore aujourd’hui, l’image sociale de la masturbation reste asymétrique, les femmes étant plus sujettes à la honte ou à la culpabilité3.
II. Ce que dit la science sur les effets de la masturbation
Contrairement aux discours moralisateurs, la masturbation n’a rien d’une menace pour la santé : elle en est plutôt un atout. Plusieurs études scientifiques ont documenté ses effets positifs à la fois physiologiques et psychologiques.
1. Bienfaits physiques
Une fréquence élevée d’éjaculation est associée à une réduction du risque de cancer de la prostate. Une revue de la littérature indique qu’environ 44 % des études convergent vers une fonction protectrice des éjaculations fréquentes4.
2. Santé sexuelle et mentale
La masturbation est associée à une meilleure fonction sexuelle, notamment du point de vue du désir, de l’orgasme et de la satisfaction. Une étude récente auprès de femmes étudiantes montre que la masturbation quotidienne est liée à une amélioration significative du désir sexuel, ainsi qu’à une meilleure image corporelle génitale5.
3. Une pratique d’autorégulation
La masturbation peut aussi agir comme une stratégie d’apaisement émotionnel ou de recentrage. À l’inverse, l’interdiction systématique, lorsqu’elle est intériorisée sans consentement éclairé, peut renforcer les tensions psychiques ou les conduites compulsives.
Plusieurs travaux en psychologie et en sexologie ont mis en évidence la fonction apaisante de la masturbation dans les situations d’anxiété ou de mal-être. Dans une perspective intégrative, elle peut être mobilisée pour se recentrer, diminuer les tensions internes et retrouver une forme de cohérence corporelle.
Cette capacité autorégulatrice est d’autant plus marquée lorsque la masturbation est vécue sans honte ni automatisme. Une étude menée auprès de 110 jeunes femmes a montré que celles qui se masturbaient régulièrement avec un sentiment de contrôle et de plaisir personnel avaient une meilleure fonction sexuelle, une image corporelle plus positive et une relation plus harmonieuse à leur sexualité5.
À l’inverse, l’interdiction rigide, qu’elle soit d’origine religieuse, culturelle ou morale, peut entraîner une tension psychique accrue. Une étude de Zimmer & Imhoff (2020) a montré que l’abstinence imposée, notamment dans les milieux marqués par des croyances religieuses strictes ou des idéaux de pureté sexuelle, pouvait favoriser des effets paradoxaux : pensées sexuelles intrusives, culpabilité chronique, voire augmentation des comportements compulsifs, sans amélioration de la santé sexuelle globale 6.
En d’autres termes, plus on s’interdit de ressentir ou d’exprimer son désir, plus le risque est grand de voir ce désir s’exprimer de manière rigide, répétitive ou déconnectée du corps. La masturbation, dans un cadre choisi et respectueux de soi, peut au contraire être un outil thérapeutique, de reconnexion à soi, d’apaisement et même de spiritualité incarnée. La clé réside moins dans le contrôle que dans la conscience.
III. Masturbation et pornographie : attention aux simplismes
La question de la pornographie revient souvent dès qu’on aborde la masturbation. Pourtant, la relation entre usage de pornographie et satisfaction sexuelle est bien moins claire qu’on ne le pense. Une méta-analyse récente portant sur plus de 70 000 participants indique une corrélation très faible, voire inexistante, entre consommation de porno et insatisfaction sexuelle7.
Le problème n’est pas tant le porno lui-même que :
- Le type de contenu (violent, stéréotypé, déconnecté de la réalité),
- Le contexte d’usage (ennui, stress, isolement),
- Et surtout la fréquence ou la compulsion8
Comme la consommation d’alcool, ou même de sucre, la masturbation peut devenir problématique lorsqu’elle est utilisée de manière automatique, répétitive, non choisie. Ce n’est pas le geste qui est en cause, mais son inscription dans un cycle de décharge ou de compensation.
IV. Privation sexuelle : que dit la recherche ?
Peu d’études se sont intéressées à la privation sexuelle volontaire. Néanmoins, certaines données montrent que l’abstinence peut entraîner une majoration de la tension psychique, de l’irritabilité et des pensées sexuelles envahissantes, notamment lorsqu’elle n’est pas choisie mais imposée par un cadre extérieur.
L’étude de Zimmer & Imhoff (2020) montre que ceux qui choisissent l’abstinence ne présentent pas une meilleure santé sexuelle, mais expriment davantage de religiosité, de conservatisme moral, et une méfiance accrue envers la science6.
V. Le mouvement NoFap : science ou idéologie ?
Le « NoFap » est un courant né sur les forums anglo-saxons, prônant l’abstinence sexuelle pour améliorer la performance, la virilité, ou la « clarté mentale ». Malgré une forte présence en ligne, aucune étude n’a démontré son efficacité. Au contraire, les participants rapportent souvent des niveaux élevés de honte, de rigidité morale et de croyances pseudoscientifiques6.
Ce n’est donc pas un modèle thérapeutique validé, mais un discours moral déguisé en hygiène de vie.
VI. Et si on réconciliait plaisir et spiritualité ?
Le carême, dans sa visée initiale, n’est pas une punition mais un retour à l’essentiel. Il invite à alléger, à choisir ce que l’on veut garder ou transformer. Dans cette perspective, la masturbation n’a pas à être bannie. Elle peut devenir un moment d’intimité, de recentrage, de conscience corporelle.
Plutôt que de tout arrêter, pourquoi ne pas ralentir ? Moins de réflexes, moins de porno, plus de présence. Plusieurs études montrent qu’une masturbation autodéterminée — vécue sans honte, avec écoute de soi — est associée à une meilleure satisfaction sexuelle et à un rapport plus apaisé au corps9.
Certaines approches thérapeutiques comme la masturbation consciente proposent d’en faire un espace de réappropriation sensorielle : moins de performance, plus de ressenti. Pas besoin d’être croyant·e pour faire du ménage dans sa sexualité.
Comme on réduit la viande ou les écrans, on peut choisir de ralentir la masturbation — non pas pour se priver, mais pour mieux se retrouver. C’est ce que Philippe Brenot appelle une « sexualité autodéterminée », libre et joyeuse : « Découvrir son corps par soi-même, c’est le point de départ d’une sexualité libre ».
Le mot des sexologues

Se priver de masturbation — que ce soit au nom d’une religion, de dogmes culturels, d’un défi personnel ou sous l’influence des réseaux sociaux — n’a rien d’anodin. Il ne s’agit pas seulement de renoncer à un plaisir, mais de se couper d’un langage fondamental du corps, d’un espace de ressourcement, de connaissance de soi, de détente et parfois même de réparation. En tant que sexologues, nous constatons tous les jours combien cette pratique peut être apaisante, réconfortante, régulatrice — à condition qu’elle soit choisie, libre, et vécue sans honte.
Ce qui rend la masturbation problématique n’est pas l’acte lui-même, mais la manière dont il est enfermé dans des représentations. Ces représentations peuvent être issues de traditions religieuses, mais aussi de normes sociales, de fausses croyances, ou de discours pseudoscientifiques diffusés massivement sur les réseaux. Aujourd’hui, les injonctions à se “détoxifier” sexuellement, à “redevenir maître de soi”, à “ne plus céder à la tentation”, circulent autant dans des groupes religieux que dans des vidéos virales qui s’habillent d’un vernis de développement personnel mais véhiculent une culpabilité profondément contre-productive.
Certaines personnes se sentent coupables de se masturber, sans toujours savoir d’où vient cette culpabilité. Parfois, elle s’ancre dans une éducation stricte. Parfois, dans un traumatisme ancien. Parfois encore, dans des discours viraux relayés sur TikTok ou Instagram, où des vidéos cumulant des millions de vues associent masturbation et “perte d’énergie”, “affaiblissement de la volonté” ou “manque de virilité”. Rien de tout cela n’est fondé sur des preuves. Tout cela entretient la confusion entre contrôle de soi et répression, entre autonomie et renoncement à ses besoins fondamentaux.
À l’inverse, une approche sexopositive consiste à reconnaître la masturbation comme une pratique potentiellement bonne pour soi — au même titre que manger, dormir, bouger, rêver. Cela ne veut pas dire qu’il faille la pratiquer tout le temps, ni en faire une norme. Cela veut dire que chacun et chacune doit pouvoir choisir, avec nuance et liberté, la place qu’il ou elle souhaite donner à cette expérience.
La régulation volontaire — ralentir le rythme, sortir de la compulsion, interroger ses habitudes — peut être bénéfique. Ce n’est pas la privation en soi qui fait sens, mais l’intention qu’on y met. Se masturber moins pour mieux ressentir, se passer du porno pour retrouver son imaginaire, prendre le temps d’être à l’écoute de son corps, tout cela peut participer d’un rapport plus doux, plus conscient, plus incarné à soi-même.
La santé sexuelle ne se mesure ni en nombres ni en interdits. Elle se mesure à la liberté de choisir, à la qualité du lien à soi, à la capacité de vivre le plaisir sans peur ni pression. Que l’on soit croyant ou non, que l’on suive un jeûne religieux, une ascèse philosophique ou une démarche strictement personnelle, la question reste la même : cette décision vient-elle de moi ? Est-ce qu’elle me nourrit ? Est-ce qu’elle me fait du bien ? Si la réponse est oui, alors elle a du sens.
Références
- France Info. Abstinence, prières et vidéos : le carême chrétien en vogue chez les jeunes et sur les réseaux sociaux. Publié le dimanche 13 avril 2025[↩]
- Brenot, P. (2021). Éloge de la masturbation. Les Liens qui Libèrent.[↩]
- Kaestle, C. E., & Allen, K. R. (2011). The role of masturbation in healthy sexual development: perceptions of young adults. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 983–994. PubMed[↩]
- Aboul-Enein, B. H., Bernstein, J., & Bowser, J. E. (2016). Evidence for masturbation and prostate cancer risk: Do we have a verdict? Sexual Medicine Reviews, 4(4), 329–332. PubMed[↩]
- Soares, R. F., et al. (2024). Masturbation, sexual function, and genital self-image of undergraduate women: a cross-sectional study. Journal of Sexual Medicine. PubMed[↩][↩]
- Zimmer, F., & Imhoff, R. (2020). Abstinence from Masturbation and Hypersexuality. Archives of Sexual Behavior. PubMed[↩][↩][↩]
- Abdi, F., et al. (2024). Effect of pornography use on sexual satisfaction: a systematic review and meta-analysis. Journal of Addictive Diseases. PubMed[↩]
- Nolin, M.-C., et al. (2024). Associations Between Contents of Pornography and Sexual Satisfaction and Function Among Young Adults. Journal of Sex Research. PubMed[↩]
- McNabney, S. M., et al. (2020). Effects of Pornography Use and Demographic Parameters on Sexual Response during Masturbation and Partnered Sex in Women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1706. PubMed[↩]