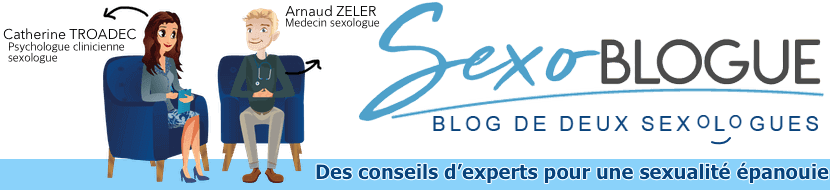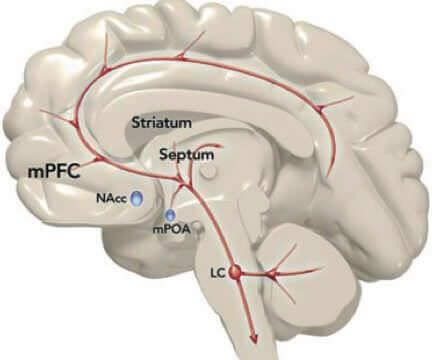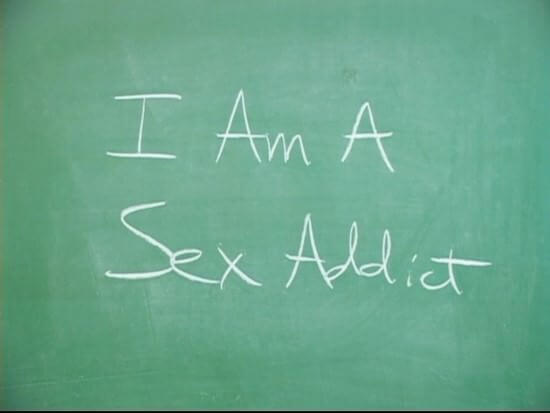Comment prendre en charge les comportements sexuels problématiques dans la Maladie de Parkinson ?

Les dysfonctions sexuelles font partie des symptômes non moteurs fréquents de la maladie de Parkinson1.
La sexualité peut être perturbée de multiples façons : directement par la maladie elle-même ou ses comorbidités, mais aussi indirectement par les traitements médicamenteux, par les conséquences générales liées à toute pathologie chronique (fatigue, faiblesse musculaire, mobilité réduite, troubles de la concentration), ou encore par des facteurs psychosociaux comme la dépression, l’anxiété, une altération de l’estime de soi, de l’image corporelle, ou des difficultés relationnelles234.
De nombreux hommes et femmes atteints de la maladie déclarent ainsi une insatisfaction sexuelle marquée5567. Dans une étude conduite auprès de personnes vivant avec la maladie, les dysfonctions sexuelles ont été classées au 12e rang des 24 symptômes les plus gênants8.
Les difficultés sexuelles rapportées se regroupent autour de deux grands axes : d’une part, une altération de la fonction sexuelle (diminution du désir, troubles de l’érection, difficultés à atteindre l’orgasme), et d’autre part, une augmentation de la préoccupation sexuelle, parfois marquée par des comportements compulsifs ou une hypersexualité910.
Si les troubles de la fonction sexuelle sont aujourd’hui bien identifiés dans le cadre de la maladie de Parkinson, les troubles du contrôle des pulsions, comme l’hypersexualité, restent en revanche moins connus du grand public comme de certains professionnels.
Alors que certaines équipes anglo-saxonnes intègrent désormais la sexothérapie dans la prise en charge globale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson11, cette approche reste encore marginale dans de nombreux contextes cliniques.
Pourtant, les professionnels de santé travaillant auprès de cette population sont régulièrement confrontés à des comportements sexuels problématiques, qui prennent souvent la forme d’un désir sexuel accru, parfois à la limite de l’obsession. Si la manifestation clinique semble similaire — un intérêt sexuel inhabituellement intense — les étiologies sous-jacentes peuvent, quant à elles, être très différentes.
On peut distinguer quatre grandes catégories de comportements à visée sexuelle problématique chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson :
- des préoccupations sexuelles liées à une dysfonction sexuelle sous-jacente, pouvant générer anxiété ou focalisation excessive ;
- une discordance de désir avec le ou la partenaire, notamment après la réapparition d’un désir sexuel précédemment émoussé ;
- une hypersexualité ou des comportements sexuels compulsifs, en lien possible avec les traitements dopaminergiques ;
- des troubles du comportement sexuel associés à un syndrome d’excitation génitale persistante (PGAD), beaucoup plus rarement évoqué mais potentiellement déstabilisant.
La capacité à différencier ces quatre profils, à en comprendre la dynamique propre et l’étiologie, constitue un levier essentiel pour adapter la prise en charge. Elle permet d’ajuster finement les interventions, qu’elles soient pharmacologiques ou non, et d’apporter un soutien pertinent tant aux personnes concernées qu’à leurs partenaires.
Comportements sexuels problématiques dans la maladie de Parkinson : mieux comprendre pour mieux accompagner
Chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les comportements sexuels problématiques peuvent prendre différentes formes, et ne relèvent pas tous de l’hypersexualité à proprement parler. Une analyse fine de ces comportements et de leurs causes est indispensable pour adapter la prise en charge.
Les préoccupations sexuelles liées à une dysfonction sexuelle sous-jacente
Les dysfonctions sexuelles sont fréquentes dans la maladie de Parkinson. Elles peuvent être liées aux symptômes moteurs ou non moteurs de la maladie, aux traitements associés (notamment certains antidépresseurs), ou à des comorbidités telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires.
Les dysfonctions les plus fréquemment rapportées incluent la dysfonction érectile et l’éjaculation précoce chez les hommes, ainsi que des difficultés orgasmiques chez les hommes et les femmes12. Ces troubles sont responsables d’une insatisfaction sexuelle importante : deux tiers des hommes et un tiers des femmes ayant des troubles de la statique pelvienne déclarent en souffrir13.
L’échec répété des rapports sexuels peut générer frustration et anxiété. Certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson s’obstinent à rechercher une expérience sexuelle « réussie », quitte à multiplier les tentatives. En cas d’orgasme non atteint, elles peuvent développer une préoccupation persistante autour de la sexualité : surinvestissement de la problématique, recherche de traitements divers, parfois non médicaux12.
Ce comportement peut être à tort interprété comme de l’hypersexualité. Il s’agit pourtant d’une tentative inefficace – mais compréhensible – de faire face à une dysfonction sexuelle sous-jacente. Une clarification s’impose souvent dès la première étape de la prise en charge : expliquer à la personne et à son ou sa partenaire ce qui se joue réellement.
Un accompagnement sexologique peut alors être proposé, incluant un repérage précis de la ou des dysfonctions et une orientation vers les spécialistes concernés (urologues, neurologues, sexologues…). La réduction de la souffrance sexuelle passe souvent par une amélioration ciblée de la fonction sexuelle.
Les sexologues peuvent également proposer des ajustements pratiques adaptés à la maladie de Parkinson, tels que :
- varier les positions sexuelles pour compenser les limitations motrices ;
- programmer les rapports aux moments les plus favorables (au pic ou à distance de l’effet du traitement) ;
- favoriser les préliminaires par le toucher sensoriel avec des huiles ou des lotions, notamment en cas de tremblements ou de raideur ;
- attendre 2 à 3 heures après la prise d’IPDE5 (comme le sildénafil ou le tadalafil) pour maximiser leur efficacité12 ;
- envisager une « fenêtre thérapeutique » de 24 à 48 heures sans ISRS (antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) pour limiter leurs effets négatifs sur l’orgasme14.
Les autres professionnels de l’équipe soignante peuvent également amorcer la discussion avec la personne, seule ou en couple. Des documents écrits peuvent également servir de support à la réflexion et faciliter la communication intime. Plusieurs études soulignent que ces supports aident les couples à mieux verbaliser leurs difficultés sexuelles15.
Divergence du désir sexuel avec le partenaire après le rétablissement du désir
Chez certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson, on observe une reprise du désir sexuel sous traitement dopaminergique. Une étude rapporte ainsi qu’environ 8,8 % des patients traités par agonistes dopaminergiques déclarent un regain d’intérêt pour la sexualité16.
Ce retour du désir est souvent bien vécu par les hommes, qui y voient un signe de vitalité retrouvée, voire une « renaissance ». Pourtant, ce changement peut générer un décalage au sein du couple.
Certaines partenaires, en particulier lorsqu’elles sont investies dans un rôle d’aidante, rapportent au contraire une baisse de leur propre désir. Ce phénomène est documenté : la charge mentale liée à l’accompagnement de la maladie peut déclencher une dépression chez les aidants17, et l’on sait que la dépression est fréquemment associée à une diminution du désir sexuel18.
Ce décalage a été conceptualisé sous le terme de divergence du désir sexuel individuel : il désigne l’écart entre la fréquence sexuelle souhaitée par une personne et la fréquence réelle au sein du couple19. Une étude menée auprès de 1 054 couples mariés a montré que cette divergence est associée à une moindre satisfaction conjugale, une communication réduite et davantage de conflits20.
Dans le contexte de la maladie de Parkinson, cette divergence est souvent mal interprétée : par les partenaires comme par les soignants, le regain de désir est parfois perçu comme de l’hypersexualité ou un comportement compulsif. Or, il s’agit avant tout d’un déséquilibre de rythme et d’envie dans la relation.
Une prise en charge adaptée commence par une explication claire de cette dynamique : ce décalage est fréquent, compréhensible, et ne traduit pas nécessairement une pathologie comportementale. La communication entre les partenaires doit être favorisée, y compris à l’aide de supports écrits ou de consultations conjointes.
Il est déconseillé de modifier prématurément le traitement dopaminergique, car cela pourrait dégrader l’état moteur ou général du patient. Des approches complémentaires – sexothérapeutiques, conjugales ou psychologiques – peuvent aider à réduire la tension et prévenir une escalade des conflits.
Enfin, dans les cas où la souffrance persiste malgré les explications, une orientation vers des professionnels spécialisés (sexologues, thérapeutes de couple ou psychologues) est indiquée. La thérapie cognitivo-comportementale peut contribuer à restaurer une dynamique relationnelle plus apaisée, en diminuant la détresse émotionnelle. Cela est d’autant plus important que le stress chronique peut réduire le contrôle de soi et augmenter les risques de comportements inadaptés21.
Hypersexualité et comportements sexuels compulsifs
L’hypersexualité est une manifestation bien documentée, bien que peu fréquente, chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Sa prévalence varie entre 1,7 % et 3,5 % selon les études222324.
Elle se manifeste par une augmentation incontrôlable du désir sexuel, pouvant prendre des formes diverses : pensées sexuelles envahissantes, besoin fréquent ou excessif de rapports, recours compulsif à la pornographie, sollicitations répétées du partenaire, appels à des lignes érotiques, contacts avec des travailleur·ses du sexe, etc.
Dans certains cas, des comportements plus atypiques ont été rapportés : masturbation compulsive, voyeurisme, fétichisme, sadomasochisme, voire dans de très rares cas, des conduites transgressives telles que l’exhibitionnisme, le frotteurisme ou des attirances déviantes (pédophilie, zoophilie)25.
Ces troubles peuvent être profondément déstabilisants pour les personnes concernées comme pour leurs proches. Le couple est souvent mis à rude épreuve : les partenaires peuvent ressentir un choc, de la détresse ou une perte de repères face à un comportement inhabituel. La famille aussi peut être impactée, notamment lorsque les comportements franchissent certaines limites sociales ou juridiques.
Les risques associés ne sont pas seulement relationnels : ils incluent aussi des problèmes de santé sexuelle (IST, grossesses non désirées), des conséquences juridiques (accusations de harcèlement, comportements inappropriés en public), et une altération du jugement favorisée par certains traitements.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition de l’hypersexualité chez les personnes parkinsoniennes :
- l’introduction ou l’augmentation des agonistes dopaminergiques,
- le syndrome de dysrégulation dopaminergique,
- des antécédents de troubles addictifs (alcool, drogues),
- des troubles psychiatriques associés,
- ou encore la présence d’autres troubles du contrôle des impulsions (comme les jeux, les achats ou l’hyperphagie).
Il est donc impératif de détecter et de traiter l’hypersexualité le plus tôt possible.
L’évaluation repose sur l’entretien clinique mais peut être facilitée par des outils de dépistage spécifiques, comme le PD-SAST (Parkinson’s Disease – Sexual Addiction Screening Test), un questionnaire conçu pour repérer l’hypersexualité dans ce contexte26.

D’après Pereira et al. Screening hypersexuality in Parkinson’s disease in everyday practice. Parkinsonism and Related Disorders, Elsevier, 2013, 19 (2), pp.242-246.
Le traitement de l’hypersexualité nécessite l’implication d’une équipe interdisciplinaire.
Elle peut inclure :
- une réévaluation du traitement dopaminergique, en collaboration avec le neurologue,
- un accompagnement sexologique ou psychothérapeutique,
- une information claire et bienveillante à destination du patient et de son entourage,
- et, si nécessaire, une orientation vers un psychiatre pour évaluer la pertinence d’un traitement médicamenteux adjuvant.
Troubles du comportement sexuel secondaires à un syndrome d’excitation génitale persistant
Un quatrième type de comportement sexuel problématique chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est lié à ce que l’on appelle le syndrome d’excitation génitale persistante (ou PGAD – Persistent Genital Arousal Disorder). Ce trouble rare, mais très invalidant, se caractérise par une sensation d’excitation sexuelle persistante, intrusive, non désirée et indépendante de tout désir sexuel ou de toute stimulation sexuelle appropriée.
Le PGAD peut s’accompagner de sensations génitales désagréables, parfois douloureuses, évoquant une montée orgasmique continue, sans aboutissement satisfaisant, ce qui engendre une grande détresse psychique. Contrairement à l’hypersexualité, le PGAD ne reflète pas une recherche active de comportements sexuels, mais plutôt une tentative d’apaisement d’un inconfort ressenti comme insupportable.
Ce syndrome a été signalé dans certains cas de maladie de Parkinson, généralement en lien avec une dérégulation dopaminergique, des lésions ou dysfonctionnements des voies sensorielles centrales ou périphériques, ou encore des troubles anxieux ou dépressifs associés. L’association entre PGAD et traitement dopaminergique n’est pas encore bien élucidée, mais certains auteurs évoquent une possible implication des agonistes dopaminergiques ou de fluctuations motrices avancées.
Le diagnostic repose avant tout sur l’interrogatoire clinique détaillé, car les personnes concernées hésitent souvent à en parler spontanément. Ces symptômes sont parfois confondus avec des manifestations d’hypersexualité, alors qu’il s’agit de deux phénomènes distincts, aux implications cliniques très différentes.
La prise en charge du PGAD chez les patient·e·s atteint·e·s de la maladie de Parkinson doit être individualisée et multidisciplinaire.
Elle peut inclure :
- une évaluation neurologique approfondie,
- une consultation sexologique pour différencier clairement les types d’excitation,
- un accompagnement psychologique, notamment si une composante anxieuse est identifiée,
- une adaptation du traitement médicamenteux antiparkinsonien, si une corrélation temporelle est suspectée,
- et, dans certains cas, des approches complémentaires (techniques de relaxation, thérapies corporelles, etc.).
L’identification du PGAD est essentielle car, mal interprété, ce trouble peut être à l’origine d’incompréhensions, de tensions conjugales ou de prises en charge inadaptées, notamment lorsque l’entourage ou les professionnels de santé y voient à tort un comportement sexuel compulsif.
Organigramme d’évaluation et de décision
Gila Bronner, Sharon Hassin-Baer et Tanya Gurevich ont développé en 2017 un organigramme d’évaluation et de décision pour la prise en charge des comportements sexuels problématiques dans la Maladie de Parkinson, en se basant sur les résultats du test PD-SAST27.

Conclusion
Les troubles du comportement sexuel dans la maladie de Parkinson sont encore trop souvent sous-reconnus, mal compris ou réduits à leur seule dimension « gênante ». Pourtant, ils traduisent une souffrance réelle, tant pour les personnes atteintes que pour leurs partenaires. Leur diversité – allant de l’insatisfaction sexuelle à l’hypersexualité, en passant par les divergences de désir ou les syndromes d’excitation persistante – invite à une lecture fine, contextualisée, et respectueuse de chaque parcours.
Il ne suffit pas de détecter ces comportements : il est indispensable d’en explorer l’origine, les mécanismes, et les impacts relationnels et émotionnels. Une approche intégrée, associant neurologues, sexologues, psychologues, soignant·e·s de proximité et partenaires de vie, permet souvent de proposer des ajustements thérapeutiques simples, mais significatifs.
En intégrant plus systématiquement la dimension sexuelle dans l’évaluation et le suivi des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, on ouvre un espace de parole nécessaire et on contribue à restaurer une part essentielle de la qualité de vie.
Références
- Chaudhuri et al. (2006) International multicenter pilot study of the first comprehensive self-completed nonmotor symptoms questionnaire for Parkinson’s disease: The NMSQuest study. Mov Disord, 21, 916-923.[↩]
- Kotkova & Weiss (2013) Psychiatric factors related to sexual functioning in patients with Parkinson’s disease. Clin Neurol Neurosurg, 115, 419-424.[↩]
- Kummer et al. (2009) Loss of libido in Parkinson’s disease. J Sex Med, 6, 1024-1031.[↩]
- Bronner et al. (2015) Sexuality in patients with Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, and other dementias. Handb Clin Neurol, 130, 297-323.[↩]
- Bronner et al. (2004) J Sex Marital Ther, 30, 95-105.[↩][↩]
- Wielinski et al. (2010) J Sex Med, 7(4 Pt 1), 1438-1444.[↩]
- Bronner et al. (2014) Parkinsonism Relat Disord, 20, 1085-1088.[↩]
- Politis et al. (2010) Mov Dis, 25, 1646-1651.[↩]
- Sakakibara et al. (2001) Auton Neurosci, 92, 76-85.[↩]
- Solla et al. (2015) Mov Disord, 30, 604-613.[↩]
- Bronner et al. Sexual Preoccupation Behavior in Parkinson’s Disease. J Parkinsons Dis. 2017;7(1):175-182. doi:10.3233/JPD-160926.[↩]
- Bronner G, & Hassin-Baer S (2012) Exploring hypersexual behavior in men with Parkinson’s disease: Is it compulsive sexual behavior? J Parkinson’s Dis, 2, 225-234.[↩][↩][↩]
- Sakakibara et Al. (2001) Questionnaire-based assessment of pelvic organ dysfunction in Parkinson’s disease. Auton Neurosci, 92, 76-85.[↩]
- Montejo et Al. (2001) Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: A prospective multicenter study of 1022 outpatients. J Clin Psychiatry, 62(Suppl 3), 10-21.[↩]
- Christopherson et Al. (2006) A comparison of written materials vs. materials and counselling for women with sexual dysfunction and multiple sclerosis. J Clin Nurs, 15, 742-750.[↩]
- Giladi et Al. (2007) New onset heightened interest or drive for gambling, shopping, eating or sexual activity in patients with Parkinson’s disease: The role of dopamine agonist treatment and age at motor symptoms onset. J Psychopharmacol, 2, 501-506.[↩]
- Grun et Al. (2016) Contributory factors to caregiver burden in Parkinson Disease. Am Med Dir Assoc, 17, 626-632.[↩]
- Atlantis E, & Sullivan T (2012) Bidirectional association between depression and sexual dysfunction: A systematic review and meta-analysis. J Sex Med, 9, 1497-1507.[↩]
- Willoughby BJ, & Vitas J (2012) Sexual desire discrepancy: The effect of individual differences in desired and actual sexual frequency on dating couples. Arch Sex Behav, 41, 477-486.[↩]
- Willoughby et Al. (2014) Exploring the effects of sexual desire discrepancy among married couples. Arch Sex Behav, 43, 551-562.[↩]
- Delaney et Al. (2012) Impulse control disorders in Parkinson’s disease: A psychosocial perspective. J Clin Psychol Med Settings, 19, 338-346.[↩]
- Weintraub et Al. (2010) Impulse control disorders in Parkinson disease: A cross-sectional study of 3090 patients. Arch Neurol, 67, 589-595.[↩]
- Voon V, & Fox SH (2007) Medication-related impulse control and repetitive behaviors in Parkinson disease. Arch Neurol, 64, 1089-1096.[↩]
- Bostwick et Al. (2009) Frequency of new-onset pathologic compulsive gambling or hypersexuality after drug treatment of idiopathic Parkinson disease. Mayo Clin Proc, 84, 310-316.[↩]
- Cannas et Al. (2007) Aberrant sexual behaviors in Parkinson’s disease during dopaminergic treatment. J Neurol, 254, 110-112.[↩]
- Pereira et al. Screening hypersexuality in Parkinson’s disease in everyday practice. Parkinsonism and Related Disorders, Elsevier, 2013, 19 (2), pp.242-246. ⟨10.1016/j.parkreldis.2012.10.017⟩[↩]
- Bronner et Al. Sexual Preoccupation Behavior in Parkinson’s Disease. J Parkinsons Dis. 2017;7(1):175-182. doi: 10.3233/JPD-160926. PMID: 27802244.[↩]